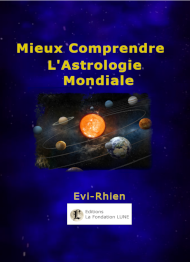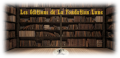Cabinet Astrologie & Astronomie

Les Bases de l'Astronomie

Carte astronomique du Ciel Nocturne
Ce sont là, les bases de l'astronomie, à connaitre.
Repérage des constellations
La sphère céleste est divisée en 88 constellations dont les trois-quarts sont plutôt difficiles à reconnaître.
Le repérage des constellations doit donc se faire à partir de celles qui sont les plus faciles à identifier et grâce aux étoiles les plus visibles.
Dans l'hémisphère Nord, (39 constellations) l'observateur doit apprendre à identifier 3 constellations au premier coup d'œil :
- La Grande Ourse ;
- Cassiopée
- Orion

Constellation de la Grande Ourse

Constellation de Cassiopée

Constellation d' Orion
Dans l'hémisphère Sud (46 constellations), il doit apprendre à reconnaître :
- La Croix du Sud
- La différencier de la Fausse Croix

Constellation de la Croix du Sud

La Fausse Croix
Trois constellations sont invisibles dans les deux hémisphères.
L'identification des constellations est facilitée par des cartes du ciel étoilé, qui varient suivant le jour et l'heure d'observation.
Reconnaître les planètes dans le ciel nocturne
Quand on lève les yeux vers le ciel nocturne, certaines étoiles que l’on voit ne sont pas des étoiles. Ce sont des planètes.
Parmi les 8 planètes de notre système solaire, 5 sont visibles à l’œil nu, en excluant la Terre évidemment :
- Mercure
- Vénus
- Mars
- Jupiter
- Saturne
Les planètes apparaissent comme des étoiles lointaines, pourtant si on sait ce qu’on cherche, on peut facilement les repérer. Il faut tenir compte du fait que ces planètes gravitent autour du Soleil, et que leur position bouge dans le ciel, au fil des jours, des mois ou des années.
Leur traque et leur suivi est d’ailleurs effectuée depuis des millénaires par les astronomes, notamment par ceux de la Rome et de la Grèce antique, qui voyaient en elles des divinités :
- Mercure (chez les Romains, ou Hermès chez les Grecs), la planète la plus proche du Soleil et se déplaçant la plus vite était le messager des dieux, parcourant le ciel entre les étoiles ;
- Vénus (chez les Romains, ou Aphrodite chez les grecs), la planète la plus brillante et la plus jolie, symbole de la fertilité et la féminité ;
- Mars (chez les Romains, ou Arès chez les Grecs), rouge de façon visible, était associée à la guerre (et ses deux lunes, découvertes bien plus tard, furent nommées Phobos, d’après la divinité de la peur, et Déimos, incarnant la terreur) ;
- Jupiter (chez les Romains, ou Zeus chez les Grecs) lente mais très brillante, était le père et le roi de tous les dieux ;
- Saturne (chez les Romains, ou Chronos chez les Grecs), la planète visible la plus éloignée de nous et donc aussi la plus lente à traverser le ciel était considérée comme la divinité du temps ;
- Neptune, Uranus, Pluton existaient chez les anciens, mais ces planètes (ou planètes-naines pour Pluton) n’étaient pas visibles et donc inconnues dans leur ciel ;
Quelques astuces pour tenter de repérer les planètes à l’œil nu. Pour certaines planètes, ce n’est vraiment pas compliqué.
Situer les galaxies
Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières, de vide et peut-être essentiellement de matière noire, contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.
La Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve le Système solaire, compte quelques centaines de milliards d'étoiles et a une extension de l'ordre de 80 000 années-lumière.
Un rapport de la mission spatiale européenne Gaia a rendu publique, le 25 avril 2018, la position de 1 692 919 135 étoiles de notre galaxie, ce qui représente moins d'1 % de la totalité des étoiles présentes dans notre galaxie.
La plupart des galaxies typiques comportent un nombre similaire d'astres, mais il existe aussi des galaxies naines comptant à peu près une dizaine de milliards d'étoiles, et des galaxies géantes comptant plusieurs milliers de milliards d'étoiles.
Sur la base de ces chiffres et de la taille de l'univers observable, on estime que celui-ci compte quelques centaines de milliards de galaxies de masse significative.
La population de galaxies naines est cependant très difficile à déterminer, du fait de leur masse et de leur luminosité très faibles.
Il pourrait donc contenir jusqu'à 2 000 milliards de galaxies, mais cela ne pourra être confirmé qu'avec les observations des futurs télescopes.
(telLes galaxies en tant que systèmes stellaires de grande taille ont été mises en évidence dans le courant des années 1920, principalement par l'astronome américain Edwin Hubble, bien que des premières données indiquant ce fait remontent à 1914.
Les galaxies sont de 4 types morphologiques principaux :
- Les galaxies elliptiques
- Les galaxies elliptiques présentent une forme sphérique ou ovale sans structure interne et de brillance à peu près uniforme. Les étoiles en leur sein vont et viennent dans tous les sens de façon désordonnée. Si elles n’étaient pas en mouvement, elles finiraient par tomber vers le centre de la galaxie et celle-ci s’effondrerait sous sa propre gravité, mais du fait de leur mouvement, les étoiles sont soumises à une force centrifuge qui les empêche de tomber vers le centre.

La galaxie elliptique NGC 1132
À 300
millions d’années-lumière
Photographie télescope spatial
- Les galaxies elliptiques sont principalement composées d’étoiles vieilles et rouges et sont plus ou moins dépourvues d’astres jeunes et massifs. Elles ne contiennent qu’une très faible quantité de gaz et de poussières et le milieu interstellaire est donc pratiquement inexistant. Ces deux faits sont liés puisque le gaz est l’ingrédient nécessaire à la formation d’étoiles. S’il est absent, aucune étoile nouvelle ne peut se former et toutes les étoiles présentes se sont donc formées à une époque où le gaz interstellaire était encore disponible. Ce sont nécessairement des astres à durée de vie très longue, donc peu massifs et rouges.
- Les galaxies spirales sont plus complexes. Elles sont essentiellement constituées de deux éléments : un noyau sphérique entouré d’un disque de matière dans lequel apparaît une structure spirale. Il y a une grande diversité de forme, depuis un noyau énorme entouré de petits bras spiraux jusqu’à un noyau minuscule avec des bras très longs.
- Cette classe de galaxies se subdivise encore en 2 groupes :
- Les spirales normales, dans lesquelles les bras se développent directement à partir du noyau
- Les spirales barrées qui présentent une grande barre centrale dont les extrémités sont le point de départ des bras (c’est le cas de notre Galaxie)
- Pour les galaxies spirales, ce
n’est pas une
agitation interne aléatoire qui empêche
l’effondrement
gravitationnel, mais une rotation globale de la
galaxie. Chaque
étoile tourne en rond autour du noyau et c’est ce
mouvement
orbital qui donne naissance à une force centrifuge.
La rotation
globale de la galaxie est également responsable de
l’aplatissement de l’ensemble et de la formation du
disque.
Les spirales possèdent des étoiles de tous les âges et de toutes les masses, ainsi qu’une grande quantité de gaz et de poussières. Là aussi les deux faits sont liés puisqu’un milieu interstellaire riche signifie qu’il y a encore suffisamment de matière pour former de nombreuses étoiles, d’où la présence d’astres jeunes et massifs. Cela n’est cependant vrai que dans les bras spiraux et, pour cette raison, les bras apparaissent plus brillants et se détachent du reste pour donner à la galaxie son aspect caractéristique. - Les galaxies irrégulières
- Il existe enfin une dernière
catégorie, celle
des galaxies irrégulières, qui contient toutes
les galaxies qui
n’entrent pas dans les trois groupes précédents.
Ces galaxies
présentent un aspect la plupart du temps
difforme et sont très
riches en gaz et en poussières. Elles peuvent
être classées en
deux groupes.
D’abord les galaxies ayant un aspect irrégulier mais dont la distribution de matière est en fait très régulière, comme par exemple les Nuages de Magellan. Celles-ci sont aujourd’hui considérées comme des spirales qui n’ont pas réussi à achever leur formation.
Le deuxième type est celui des galaxies véritablement irrégulières, autant du point de vue visuel que de celui de la répartition de matière. Cette irrégularité peut avoir diverses origines comme une forte activité dans le noyau ou bien une collision passée avec une autre galaxie.

La galaxie spirale NGC 1232
située à
100 millions d’années-lumière
D’un diamètre d’environ
200.000 années-lumière
(Constellation Eridan)

La galaxie spirale barrée NGC 1365 photographiée par le VLT

La galaxie
lenticulaire NGC 5866
À 45
millions d’années-lumière
Photographie le télescope
spatial

Le Grand Nuage
de Magellan
Une galaxie
irrégulière
À 160.000 années-lumière
30.000 années-lumière de
diamètre
Une description plus étendue des types de galaxies a été donnée à la même époque par Hubble et est depuis nommée séquence de Hubble.
Comprendre les cycles
Un cycle n’est pas une boucle fermée, mais une suite structurée chronologiquement de phases de développement du processus vital. À la fin du cycle, s'il semble revenir exactement en sa position originale, il fait en réalité plus que cela, il va au-delà pour produire l’évolution, le sens créateur, du moins si le processus en spirale a été optimal.
Si ce n’est pas le cas, le cycle prendra effectivement un aspect d’événements répétitifs, du moins le temps que l’apprentissage et la leçon du cycle soient retenus.
Ce sont bien les cycles dans leur globalité qui ont une signification, non un simple point indiquant la simple position figée d’une planète particulière à l’instant T, faisant un aspect particulier isolé à une autre planète figée, etc ...
Établir des orbites
En mécanique céleste et en mécanique spatiale, une orbite (/ɔʁ.bit/) est la courbe fermée représentant la trajectoire que dessine, dans l'espace, un objet céleste sous l'effet de la gravitation et de forces d'inertie.
Une telle orbite est dite périodique.
Dans le Système solaire, la Terre, les autres planètes, les astéroïdes et les comètes sont en orbite autour du Soleil. De même, des planètes possèdent des satellites naturels en orbite autour d'elles.
Des objets artificiels, comme les satellites et les sondes spatiales sont en orbite autour de la Terre ou d'autres corps du système solaire.
Une orbite a la forme d'une ellipse dont l'un des foyers coïncide avec le centre de gravité de l'objet central. D'un point de vue relativiste, une orbite est une géodésique dans l'espace-temps courbe.
Mes Ouvrages
L'astrologie mondiale
2019
____________